Le peuple poète ?
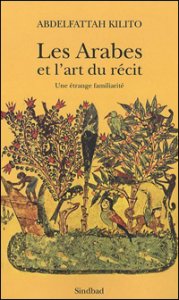
Depuis la nuit des temps, les Arabes sont considérés avec une certaine complaisance comme étant un peuple féru de poésie, voire comme étant LE peuple poète, comme il y aurait LE peuple élu, LE peuple des intouchables, etc. Autant de billevesées qui nuisent à la bonne marche du monde, mais personne n’ose encore briser ces canons absurdes qui paralysent l’entente cordiale … Si, en effet, la poésie était bien le registre de leurs hauts faits, ces Arabes, hérauts magnifiques qui annonçaient les plus belles pages de la littérature à venir, s’enorgueillissaient de leur talent et cultivaient l’art du vers comme un jardin secret … Encore de nos jours, les peuples du Proche et du Moyen Orient frissonnent de plaisir quand ils entendent déclamer les vers de Mutanabbî ou de Ma’arrî … sans parler d’un certain Mahmoud Darwich qui remplissaient des salles de milliers de fans, à faire pâlir de jalousie les crétins laqués de la Star’Ac qui peinent à avoir quelques centaines d’ados boutonneux venir les voir massacrer des classiques du répertoire …
Or, dès les premiers siècles de l’hégire, il fut décrété – par quel illuminé ? – que la poésie arabe n’était pas traduisible. Toute traduction est une trahison, par définition, et la poésie plus encore est intraduisible par essence, mais, car il y a toujours un mais, sans quoi le monde serait terne et fade, la maîtrise des deux langues permit aussi, grâce à de valeureux et consciencieux poètes, de pouvoir entendre dans d’autres langues cette psalmodie si particulière qu’est la métrique arabe. Une fois les rivalités enfouies, les partisans de la philosophie grecque et les défenseurs de la sagesse persane reconnurent le caractère merveilleux et universelle de la poésie arabe. Tout en confirmant son intraduisibilité (sic) …
Ces perfides allèrent même jusqu’à dire qu’il était vraiment dommage que seuls ceux qui comprenaient l’arabe avaient la chance d’approcher un discours sapiential qui se prêtait si bien au transfert et profiterait à tout un chacun, sauf que …
Et passèrent les siècles sans que le statut de la poésie arabe ne varie. La faute sans conteste aux Européens qui l’a boudèrent, estimant – non sans raison, mais jamais de manière aussi radicale – que le récit est l’apport majeur des Arabes. Est-ce donc un hasard si Cervantès attribua la paternité de Don Quichotte à un historien arabe du nom de Sidi Ahmed Benengeli ? De même, Antoine Galland nota bien que Les Mille et Une Nuits "font voir combien les Arabes surpassent les autres nations en cette sorte de composition" (A. Galland, Les Mille et Une Nuits, Flammarion, 1965). Lequel Galland n’a pas jugé opportun de traduire les vers qui parsèment les Nuits car leur beauté est en arabe et les Français ne peuvent y goûter (sic). Ainsi, les Arabes qui s’estimaient les maîtres de la poésie sont, à leur insu, présentés comme les meilleurs conteurs du monde !
Ils comprendront enfin la supercherie – et tout l’aspect négatif qui entoura cette généralité – vers le milieu du XIXe siècle, lorsqu’ils constateront l’extraordinaire fortune du livre des Nuits, traduit par le même Galland dans toutes les langues européennes … Entre temps, ils avaient adopté la prosodie, la fiction et la dramaturgie – formes qui leur étaient étrangères – pour tenter de renouveler leur littérature. Déjà sous influence, déjà marginalisés et tentant de copier l’Occident au lieu de s’affirmer tels qu’en eux-mêmes …
Pris aux pièges, les Arabes tentèrent alors de légitimer ce mouvement en reconsidérant leur tradition littéraire, poussés en quelque sorte, aussi, par les "orientalistes". Et tout le monde y trouvait son compte dans cette récupération mercantile et politique qui brisait une culture plusieurs fois millénaires et parvenait petit à petit, tel un virus, à infester le monde arabo-muslman des valeurs occidentales taxées aujourd’hui de décadentes par les fondamentalistes religieux.
Néanmoins, l’aspect positif de cette mixité imposée fut une réinterprétation et une revalorisation du corpus narratif ancien. La littérature arabe fut en quelque sorte régénérée grâce à l’épreuve de l’autre ; et, désormais, les deux sont inséparables.
Ce rapprochement – contre nature ? – repose inéluctablement sur une sélectivité : le sentiment de supériorité de l’homme blanc lui impose de distinguer une œuvre arabe dans son rapport – à sens unique – avec une œuvre européenne. Quand un texte ne témoigne pas de ce rapport, il est négligé, voire condamné à un bannissement hors du corpus reconnu et érigé en étalon. C’est, par exemple, ce qui arriva au Livre des avares de Jâhiz, nonobstant un sommet de l’art narratif ; mais l’on ne put le relier à L’Avare ou à Madame Bovary.
Par contre, les œuvres qui, encore une fois suppose-t-on (à dessein ?), auraient exercé une certaine influence – plus ou moins reconnue – sur la littérature européenne jouissent d’une certaine renommée, voire sont portées aux nues. C’est le cas de Kalîla et Dimna très souvent associé aux fables de La Fontaine, des
Séances de Hamadhânî et de Harîrî, reliées au roman picaresque, de L’Epitre du pardon de Ma’aarî, rattachée à La Divine Comédie, etc.
Un livre, ce livre, tisse le lien distendu qui unie, dans une fécondité née d’un malentendu, cet art du récit d’un peuple stigmatisé comme seul enclin à la poésie.
Abdelfattah Kilito est professeur à la faculté de lettres de Rabat. Lauréat, en 1996, du prestigieux prix du Rayonnement de la langue française, attribué par l’Académie française, cet essayiste de talent vous entraînera sur les pistes oubliées – mais ô combien envoûtantes –de Mu’tamid à Harîrî, sans oublier Averroès, Ibn Tufayl ou Jâhiz …
Une indispensable remise à plat.