Elfriede Jelinek est bien une voix singulière de la littérature que ce pavé de mille pages consacré par Actes Sud vous démontrera aisément en vous faisant croiser tant de figures à la fois familières et inquiétantes, tant d’époques différentes que vous perdrez pied : vous serez catapulté si loin de vos certitudes que vous resterez sans voix quand Jelinek vous entraînera sonder cette roche autrichienne sous laquelle sont ensevelis, tels les Titans, les morts et les non-morts, les vivants indésirables, les damnés de la terre, un passé refoulé jusqu’à la négation la plus complète. Il vous faudra du courage pour entrer dans cet univers et vous engager dans un voyage à travers le temps et l’espace. Mais, ô grand jamais, vous ne le regretterez ; bien au contraire.
Souvent raillée par les sots pour son écriture qui se résumeraient à des diatribes lancées contre son pays natal, Elfriede Jelinek, comme toute une génération d’auteurs autrichiens de l’après-guerre, surtout Thomas Bernhard, n’a jamais pu s’accommoder de cette amnésie partielle dont souffre l’Autriche. Ainsi, elle n’aura de cesse de s’attacher, dans son œuvre, à déchirer le voile pudique posé sur ce passé récent. Elle tente, par exemple, de nommer le mensonge historique en l’érigeant comme thème central du récit, comme dans Les Exclus - en quelque sorte la matrice la plus narrative de ce couple qui hante l’ensemble de ses textes : la victime coupable et le coupable innocent - mais aussi à travers l’écriture elle-même.
De la sorte, elle a construit, de texte en texte, une œuvre complexe et protéiforme. Elle est l’auteur contemporain au sens où sa matière première est le présent qu’elle analyse, ausculte et démonte pour le couler dans des formes esthétiques très diverses : romans, pièces de théâtre, essais, livrets d’opéra, pièces radiophoniques et scénarii.
Elle n’est pas l’auteur d’un seul livre décliné à l’infini, comme peut l’être Jean d’Ormesson ; mais elle est à classer dans la catégorie des virtuoses de l’expérimentation. Elle ose tordre le cou à la langue afin de lui faire dire ce qu’elle veut cacher. Chacune de ses œuvres est un laboratoire unique de sémantique : on y trouve toutes sortes d’expériences sur les différentes manières de mixer, examiner, mettre en scène voire mettre en bouche toutes les palettes du discours sur l’homme et la femme, le sol et la patrie, l’art et la nature ; sur la guerre économique, idéologique, hégémonique entre les classes sociales et entre les sexes.
L’Autriche est le pays de la musique, qui depuis un certain premier janvier 1939, nous impose sa ritournelle de valses en polkas célébré par ce concert de Nouvel An donné par l’orchestre philharmonique de Vienne, retransmis simultanément dans cinquante-cinq pays, en direct de la salle d’Or du Musikverein, que l’on m’impose à la maison tous les ans et que j’abhorre tout particulièrement. Mais mon cas personnel importe peu et revenons à notre sujet.
Elfriede Jelinek a eu une enfance et une adolescence entièrement dictée par la musique, poussée par une mère ambitieuse. Pour y échapper, une seule solution : la littérature, un domaine auquel sa mère ne comprenait rien. Mais il faut reconnaître que le style Jelinek est certainement le fruit de cette musique étudiée si intensément car il est affaire de composition et de voix.
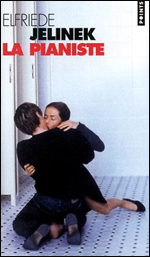 En France, ce fut le film de Michael Haneke, en 2001, qui fit connaître Jelinek au grand public, mais La Pianiste était déjà un succès dans les pays de langue allemande depuis sa sortie, en 1983. Et il ne se résume pas au récit que le film mit en scène, réducteur comme toujours l’est une œuvre cinématographique, toute aussi réussie soit-elle ; non, loin de là, La Pianiste aborde tous les thèmes qui gravitent autour ce celui qui choisit d’écouter les sirènes qui promettent la gloire éternelle : illusions que tout cela. Car non seulement l’art omet de nourrir ceux qui s’en repaissent, mais il finit par les dévorer. Vienne, cette ville de la musique qui s’enorgueillit de sa tradition artistique, Vienne, comme tous les mythes, n’en finit pas de mourir dans La Pianiste, qui est aussi l’histoire d’une ville : "Sur sa panse boursouflée de culture et qui continue d’enfler au fil des ans comme ces corps de noyés que l’on ne repêche pas, les boutons sautent."
En France, ce fut le film de Michael Haneke, en 2001, qui fit connaître Jelinek au grand public, mais La Pianiste était déjà un succès dans les pays de langue allemande depuis sa sortie, en 1983. Et il ne se résume pas au récit que le film mit en scène, réducteur comme toujours l’est une œuvre cinématographique, toute aussi réussie soit-elle ; non, loin de là, La Pianiste aborde tous les thèmes qui gravitent autour ce celui qui choisit d’écouter les sirènes qui promettent la gloire éternelle : illusions que tout cela. Car non seulement l’art omet de nourrir ceux qui s’en repaissent, mais il finit par les dévorer. Vienne, cette ville de la musique qui s’enorgueillit de sa tradition artistique, Vienne, comme tous les mythes, n’en finit pas de mourir dans La Pianiste, qui est aussi l’histoire d’une ville : "Sur sa panse boursouflée de culture et qui continue d’enfler au fil des ans comme ces corps de noyés que l’on ne repêche pas, les boutons sautent."
 Avec Lust Jelinek est allée aussi loin que possible dans sa tentative d’explorer la continuation du fascisme en se plongeant dans les structures familiales et conjugales. Initialement, Lust devait être un contre-projet à Histoire de l’œil de George Bataille, une tentative d’écrire la sexualité au féminin. Mais elle y renonça car "il ne peut y avoir de langue spécifiquement féminine du plaisir et de l’obscénité, parce que l’objet de la pornographie ne peut développer de langue qui lui soit propre."
Avec Lust Jelinek est allée aussi loin que possible dans sa tentative d’explorer la continuation du fascisme en se plongeant dans les structures familiales et conjugales. Initialement, Lust devait être un contre-projet à Histoire de l’œil de George Bataille, une tentative d’écrire la sexualité au féminin. Mais elle y renonça car "il ne peut y avoir de langue spécifiquement féminine du plaisir et de l’obscénité, parce que l’objet de la pornographie ne peut développer de langue qui lui soit propre."
Lust fit scandale en Allemagne mais cette abjection du passé projetée dans le corps, la sexualité, la nature et la cellule familiale dépasse de loin les frontières de l’étouffoir autrichien : elle s’attaque à l’essence même des êtres et des choses.
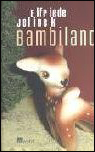 Elfriede Jelinek écrit Bambiland au début de la guerre en Irak, en 2003. Elle affirme que son titre se réfère à un parc de loisirs près de Belgrade qui appartenait à Marko Milosevic, mais aussi à une revue éditée par Udai Hussein, intitulée Babilan.
Elfriede Jelinek écrit Bambiland au début de la guerre en Irak, en 2003. Elle affirme que son titre se réfère à un parc de loisirs près de Belgrade qui appartenait à Marko Milosevic, mais aussi à une revue éditée par Udai Hussein, intitulée Babilan.
Ce texte qui se présente en un bloc, voire un fleuve où les instances d’énonciation alternent brusquement sans toujours se laisser identifier, s’achève par un épilogue qui s’ouvre sur la seule didascalie du texte : "Dieu quel qu’il soit apparaît dans un nuage et dit enfin la vérité qui commençait à nous manquer."
Ne nous trompons pas, Bambiland n’est pas un texte sur la guerre mais sur la façon dont elle est perçue, interprétée, assimilée. Aux multiples discours des médias, parasités par la ligne mélodique si particulière de la tragédie antique, s’ajoute une troisième voix, celle de l’auteur, spectatrice impuissante qui compense cette impuissance par une ironie d’autant plus mordante qu’elle est froide.
Le texte naît de l’imbrication de ces registres : les reflets du réel dans les médias, dans la tragédie antique et dans une subjectivité contemporaine et isolée, celle de l’auteur, se juxtaposent et se superposent pour former une trame complexe et oscillante où le fondu enchaîné semble être la règle.
Ecrit plus pour être joué que lu, ce texte théâtrale est sans doute parmi les défis majeurs posés au théâtre contemporain ...
 S’il ne faut retenir qu’un seul qualificatif au sujet d’Elfriede Jelinek, c’est son travail sur la langue, ce travail titanesque qui consiste à rendre audible, à rendre visible ce qui s’immisce dans le langage, à faire entendre les voix qui parlent avec nous lorsque nous parlons, à forcer la langue à se dévoiler, afin qu’apparaissent les mécanismes qui nous gouvernent. Ils sont nombreux, et nous déterminent de l’extérieur comme de l’intérieur.
S’il ne faut retenir qu’un seul qualificatif au sujet d’Elfriede Jelinek, c’est son travail sur la langue, ce travail titanesque qui consiste à rendre audible, à rendre visible ce qui s’immisce dans le langage, à faire entendre les voix qui parlent avec nous lorsque nous parlons, à forcer la langue à se dévoiler, afin qu’apparaissent les mécanismes qui nous gouvernent. Ils sont nombreux, et nous déterminent de l’extérieur comme de l’intérieur.
Trop de sexe, trop de violence, trop de manichéisme ? C’est cela qui gène tant ? Tant mieux, la réaction provoquée montre qu’elle a touché ce qui fait mal : d’ailleurs ses textes sont des palimpsestes. En cela elle est bien l’héritière d’une tradition autrichienne d’une réflexion philosophique sur le langage telle qu’elle fut inaugurée par Fritz Mauthner ou Ludwig Wittgenstein, qui pose le langage comme moyen de la connaissance. Depuis l’Antiquité, on nous a enseigné à nous méfier des apparences et des images chatoyantes du monde. Avec Elfriede Jelinek nous apprenons à nous méfier de l’instrument même de la connaissance : du langage, surtout quand il a l’air si naturel ...
