Je m’appelle Elisabeth
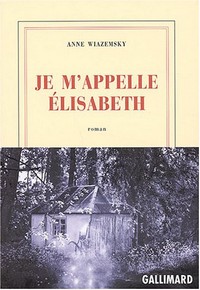
Les esprits chagrins diront que ce court roman est une longue nouvelle, que les éditeurs fabriquent de plus en plus de petits livres qui se lisent facilement, vite et bien, et que l’on oublie sitôt refermés. Je m’insurge contre ce cliché, même s’il faut reconnaître que les livres maigrissent aussi vite que les caractères d’imprimerie grossissent. Mais ce débat n’est pas le sujet.
Si Anne Wiazemsky nous narre une courte histoire, c’est aussi parce qu’elle l’imprime directement dans la duére, dans le rapport au temps qu’entretient l’un des deux personnages principaux. Elle n’est pas ici pour faire du patos ou noircir des pages inutiles : on ne fabrique pas un livre comme une cale d’armoire normande. On cisèle son propos, un suggère, on induit une atmosphère.
On plante un décor. Et l’on joue avec.
Ici, tout se déroule dans une cabane. Dans une absence de lumière, dans les ombres déclinées par l’ultime œil de bœuf qui laisse un peu de clarté prendre forme sur les murs, dans cette atmosphère tendue se peint le drame. Et lorsque l’on ressort pour accompagner la petite Betty, douze ans, on ne peut oublier ce qui s’y cache, ce cœur qui vibre, cette âme prisonnière de sa propre enveloppe, souffrance dans la souffrance, noirceur immobile dans la pureté oubliée d’un amour diffus, qui demeure, à l’abri des regards …
Betty est la petite dernière, la "numéro cinq", la préférée de son père, psychiatre, directeur d’un hôpital, situé à une vingtaine de kilomètres de Saint Etienne, dans lequel vit toute la famille, dans une petite maison, derrière un mur dissimulé par une haie d’arbres qu’entretient un malade jardinier. Car les méthodes de monsieur père sont nouvelles pour ces années 60 : pas de camisoles, pas d’électrochocs ni de contraintes par corps. Les malades sont libres. Le parc est vaste et clos, il n’y a donc pas de risque d’évasion.
Quoique.
Un soir, Betty sursauta, elle était certaine d’avoir entendu crisser le gravier. Quelqu’un se déplaçait le long du mur de la villa, se rapprochait de sa chambre. Alors « la jeune fille se leva et se dirigea vers la fenêtre avec le sentiment précis qu’une chose horrible l’y attendait. Elle ne se trompait pas. Posée sur le rebord, la tête décapitée d’un écureuil la regardait. »
Des petits malins s’amusent à vouloir l’épouvanter ? Qu’à cela ne tienne. Elle saura leur démontrer qu’elle n’a pas peur. Car Betty va entrer dans l’âge adulte en l’espace de trois jours. Apprendre à dominer l’inconnu, à défier l’autorité, à mentir, à tromper, à dissimuler, à voler … par amour, par compassion pour Yvon, son fou, venu se réfugier dans sa cabane, au fond du jardin, entre son vélo et ses lapins.
Naîtra de cette relation une tendre passion, une amour impossible au-delà des normes que la société applique, puisque sans aucune référence. Un homme au-delà de la quarantaine, une fillette innocente, une situation décalée et des regards, des souffles, des silences et des odeurs, des sauts dans le vide comme si la montre s’arrêtait et que dans la distorsion du temps les affinités électives se retrouvaient sur les chemins, semelles de vent et voleur de feu sur la même berge. La crise de Cuba est ailleurs, les années 60 sont un alibi. L’innocence est seule et éclabousse de toute sa beauté dans un seul geste, un échange, l’unique, un don, une seconde d’éternité qui donnera son point de départ au récit, puisque c’est en apprenant le parcours de cet objet offert que la narratrice pourra alors ouvrir la porte des souvenirs et laisser filtrer quelques morceaux d’enfance oubliée, quelques instants de vie, sans doute les plus essentiels, les plus merveilleux de son existence, mais, qui, du fait même de leur déroulement, avaient été occultés dans l’inconscient.
Le cadeau d’une fillette à un homme malade, introvertis, à la limite de l’autisme, mais un homme doux, bon, qui n’aura de cesse de parler toute sa vie durant de "la fille du docteur", et de tenir dans son poing, dans sa poche, le ruban écossais, qu’une certaine Elisabeth lui avait offert, et qui a été son bien le plus précieux.
Anne Wiazemsky
Je m’appelle Elisabeth
Gallimard, 2004
168 p.- 14,50 euros