Lorsque le privé devient public. De l’abnégation à l’éthique de la responsabilité
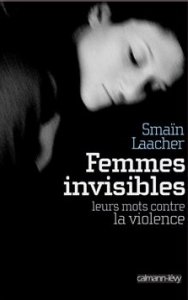
Dans son dernier ouvrage, "Femmes invisibles"(Calmann-Lévy). Leurs mots contre la violence, Smaïn Laacher, sociologue et chercheur au Centre d’études des mouvements sociaux, met en lumière les pratiques et les modes de publicisation de la violence privée vécue par les femmes étrangères et d’origine étrangère.
Cette étude qui propose une connaissance sociologique sur le monde domestique des populations immigrées et/ou issues de l’immigration et ses différentes formes de violences, met en scène des femmes appartenant majoritairement aux classes populaires, qui, pour la première fois, sortent de l’invisibilité et brisent la loi du silence en osant franchir ce qui relevait de l’ordre de l’invisible, du tabou et de l’infranchissable.
Mariées et/ou célibataires, ces femmes expriment des souffrances d’ordre privé par la médiation de l’écriture et du téléphone en utilisant le langage de « l’école », du « droit » et de la « raison » pour dire, nommer, définir, interroger, révéler et solliciter de l’aide dans le but d’affirmer leur « refus de l’enfer à huis clos pour lui substituer la recherche d’un tiers qui restituera à chacun son dû ».
Et c’est par le biais de deux associations, « Ni Putes Ni Soumises » (N.P.N.S.) et Voix de Femmes (V.D.F) que Smaïn Laacher a eu accès à cette parole féminine qui relève de l’ordre de l’intimité.
Le corpus de cette recherche regroupe 261 lettres manuscrites portant sur le harcèlement moral, la violence conjugale, le mariage forcé, les violences intrafamiliales … ; 401 fiches téléphoniques et une trentaine d’entretiens approfondis menés auprès de femmes ayant fait l’objet de violences. Au moment de l’entretien, certaines avaient porté plainte alors que d’autres pensaient le faire.
Ce matériau « inédit », « unique et précieux » semble revêtir une dimension particulièrement innovante car il constitue selon l’auteur « des modes d’expression et de contestation discrets ou invisibles - et - instructifs sur la relation entre privé et public et ses modifications en cours »
Cette écriture de soi sur soi. Cette mise à nu de soi à travers ces moments biographiques appréhendés essentiellement comme des « sources de connaissances ». Ces mots qui décrivent, dévoilent, révèlent pour « dénoncer » ce que ces femmes ont vécu, vivent et ne veulent plus vivre. Ces souffrances exprimées sous forme de « protestation publique » « qui doit être entendue comme un tord qui demande à être reconnu, autrement dit qui ne doit pas échapper à une exigence de justice ou qui demande à être départager en justice » sont autant d’indices et de facteurs qui permettent de saisir de l’intérieur les systèmes de valeurs et les « univers de croyances » de ces femmes qui s’interrogent sur le « sens du juste et de l’injuste » et qui font appel au droit pour obtenir réparation.
Et c’est à l’intérieur de ces « mondes » que Smaïn Laacher nous invite à nous immerger à travers sa parole de chercheur qui propose une compréhension et une reconstruction des définitions des situations vécues par ces femmes, de leurs motivations et des finalités de leur acte que l’auteur définit comme « volontaire et souverain ». Car « ce nouveau pouvoir de décider elles-mêmes comment et à quelles conditions réagencer ou, mieux encore, réordonner les différentes affiliations qui déterminent ce qu’elles ont et ce qu’elles sont » vient inévitablement contribuer à opérer un changement dans la conception qu’elles portent à l’égard de leur personne. Et d’autre part, dans la représentation de la société à l’encontre de ces femmes immigrées et/ou issues de l’immigration.
Ainsi, en faisant appel au droit, ces femmes se « constituent comme des sujets » qui expriment leur volonté de s’approprier leur corps et leur vie et ainsi « l’accès à la dignité ».
"Tout le mal qu’elles ont dit du mal qu’on leur faisait, elles l’ont défini comme un nouveau pouvoir de
décider elles-mêmes" Smaïn Laacher
Le mague : Femmes étrangères et/ou d’origine étrangère face aux violences intrafamiliales et conjugales. Un nouvel objet de recherche que tu explores ?
Smaïn Laacher : En réalité, cet objet de recherche est nouveau dans le champ précis de l’immigration. Dans les années soixante et soixante dix, j’ai publié plusieurs textes avec Dominique Cardon sur les dispositifs radiophoniques animés par Menie Grégoire. J’ai travaillé sur la parole intime des femmes qui envoyaient des courriers à l’animatrice de l’émission « Allo Menie » diffusée sur R.T.L. de 1967 à 1981. A cette époque, il s’agissait essentiellement d’une protestation publique et d’une revendication qui s’exprime par le désir d’un réaménagement des rapports entre les hommes et les femmes dans l’espace privé et public.
Depuis quelques années, les violences conjugales et familiales font l’objet d’un intérêt institutionnel sur le plan national et international. Est-ce un facteur qui a contribué à t’orienter vers ce champ de recherche ?
Ce sont essentiellement les controverses parfois idéologiques, parfois très culturalistes autour de ce thème qui m’ont incité à regarder de plus près. D’une manière générale, les thèmes dominants tournent autour d’une question fondamentale qui se décline comme suivant : « est ce que les Musulmans battent plus que les autres leurs femmes » ? Dit autrement, est ce que les femmes des Musulmans sont plus violentées que celles des autres femmes appartenant à d’autres communautés confessionnelles et nationales ? Les réponses à cette question mettent en lumière deux attitudes antagonistes. Pour certain( e)s, les Musulmans ne battent ni plus ni moins leurs femmes qu’ailleurs. Pour d’autres, la violence constitue un véritable problème dans ces communautés et l’Islam, joue directement ou indirectement un rôle en autorisant et en légitimant la violence faite aux femmes. J’ai voulu renvoyer dos à dos ces deux points de vue car ils sont fondamentalement idéologiques, c’est-à-dire que ce sont des constructions d’en haut et de haut sur des univers qui n’ont jamais été explorés sous ces angles là. Dans la première réponse personne n’a de réponse statistique ; il n’y a jamais eu de tentative de mesurer qualitativement et qualitativement la violence familiale et conjugale dans ces univers sociaux et confessionnels. La deuxième réponse est souvent sans nuance. Que l’islam concret et pratique ne soit pas étranger aux phénomènes de violences familiales est une chose, encore faut il le montrer.
Tu qualifies ces femmes d’« invisibles ». Que recouvre cette notion d’invisibilité ?
Pour parler comme Michel Foucault, ces femmes sont ces vies dans l’ombre. Ces vies de l’ombre. Ces vies infâmes, indignes d’êtres contées et racontées.
Le point de vue d’en haut et de haut est un point de vue intellectuel des intellectuel( le)s. Les problématiques dont parlent ces femmes ont été très peu prises en compte car on estimait à tord ou à raison que ces populations, maris et femmes, étaient confrontés à des problèmes beaucoup plus graves, en l’occurrence le racisme, l’intégration…
Dans le contexte de cet ouvrage, la notion d’invisibilité renvoie donc à un désir de sortir de l’ombre des vies qui ont été jugées indignes d’être examinées par la « science » et les défenseurs vertueux de tous les immigrés.
Cette étude propose une connaissance sociologique du monde domestique des populations immigrées et d’origine immigrée et ses différentes formes de violence à travers le témoignage des femmes qui en font l’objet. En quoi cette parole qui dit et dénonce ces violences sous forme de plainte est-elle importante ?
Elle est importance dans le sens où elle était privée et elle devient publique. Le passage du privé au public s’effectue par le truchement de l’écriture. Cet acte de protestation publique par le biais de l’écriture est socialement et historiquement inédit. Se saisir de l’écriture pour porter sa souffrance privée et sa protestation dans l’espace public et solliciter de l’aide est un comportement qui est probablement plus du fait des femmes que des hommes.
Cette écriture féminine laisse apparaître l’exercice de plusieurs types d’efforts. Cependant, ce qui m’a paru extrêmement important c’est le fait que ces femmes dénuées d’expérience en matière de protestation publique exposent des souffrances privées et s’adressent à des institutions légitimes reconnues comme telles pour réclamer que le tord subi soit reconnu et réparé par le biais de la justice.
Et dans le cadre de cette étude, il m’a semblé plus pertinent de m’intéresser, d’une part, à la manière dont ces femmes ont résisté aux épreuves de violences. Et d’autre part, comment elles ont organisé et construit à la fois un sens critique de leur condition, mis en forme des pratiques de résistance et un travail d’inclusion de l’espace public dans l’espace privé.
Comment la parole de ces femmes permettra-t-elle au sujet de la violence conjugale et familiale de dépasser « le stade de la rhétorique méthodologique ou militante » ?
Les textes du féminisme nouveau genre qui se définissent comme proches et prenant systématiquement la défense des immigrés proposent d’articuler des catégories qui ne sont pas forcément et systématiquement reliées dans la réalité, en l’occurrence, le sexe, la race et l’ethnie. Par ailleurs, ces féministes prenant et prônant la défense de tous les immigrés ou des populations d’origine immigrée pensent, a mon avis à tort, que si les violences sont spécifiées, il y a un risque de stigmatiser les immigrés. Les travaux réalisés dans cette perspective « théorique » sur cette question relèvent plutôt d’une banale sociologie de la domination et de la violence des hommes sur les femmes. Avec toute la meilleure volonté du monde, j’ai du mal à situer les grandes avancées théoriques dans le domaine qui nous préoccupe ici. Ce ne sont pas les controverses intellectuelles ultra sophistiquées qui m’intéresse. Car mon objectif est d’examiner des épreuves au plus près des pratiques des personnes. J’essaye tout simplement de faire de la sociologie et d’être un peu imaginatif quant aux matériaux sur lesquels m’appuyer.
Qui sont ces femmes qui portent leur plainte sur l’espace public via les associations ? Quel est leur profil socio-professionnel ?
En travaillant sur le courrier et les fiches téléphoniques, j’ai fait le constat de l’existence de similitudes avec le courrier envoyé à Menie Grégoire. Il y a très peu d’information sur le capital scolaire, la profession, la profession des parents… Il y a un certain nombre d’indices qui renvoient au fait qu’il y a très peu de chance qu’elles soient d’origine bourgeoise.
Les femmes qui ont écrit à « Ni putes Ni soumises » et à « Voix de femmes » sont majoritairement nées en France. Cet aspect est une variable très importante. Elles utilisent l’écriture comme mode de protestation. Elles ont été à l’école et elles ont compris que la protestation par le biais de l’écriture est un mode légitime de contestation. Elles reconnaissent une efficacité à la raison scolaire ou à la raison juridique dans les demandes de réclamation. C’est une reconnaissance du droit comme mode dominant de régulation des rapports entre les personnes dans l’espace domestique. Dit autrement, du point de vue de ces femmes, c’est le droit qui doit gouverner les relations et non la force.
Quels types de violences évoquent-elles ? Existe-t-il des formes dominantes ?
Les violences dominantes sont de deux ordres : conjugales et intrafamiliales, dans le dernier cas il s’agit de mariage forcé. Il y a bien évidemment les violences qui sont traditionnellement attachées à ces deux violences tes que le harcèlement, la violence symbolique, le mépris, l’humiliation … Dans les deux cas, c’est un attentat au corps et à l’esprit.
Comment ces violences se manifestent-elles ?
La violence conjugale se manifeste à travers les corps. Pour le mariage forcé, c’est plus compliqué. La violence physique n’est ni le premier mode de soumission ni le premier argument. Elle intervient en dernier lieu. Lorsque la soumission n’a pas été obtenue par la mobilisation de l’argument de la religion, de la tradition, des valeurs…, c’est alors que la violence physique peut être mobilisée pour soumettre la jeune fille. Dans la violence conjugale, la violence se fait au nom du pouvoir souverain de l’homme.
Les courriers et les appels téléphoniques laissent transparaître une volonté de dégagement de la violence. Quelle est la nature du langage utilisé pour l’exprimer ?
Ces femmes savent qu’elles écrivent pour être lues et entendues. Elles sont conscientes que les catégories d’entendement du récepteur ne doivent pas rencontrer de difficulté pour lire la lettre de l’expéditeur. Il faut donc d’une certaine manière qu’elles anticipent sur le système d’attente du récepteur qui est le plus souvent une institution, c’est-à-dire un procureur, une association, un avocat, un psychologue … Et comme elles souhaitent que le récepteur comprenne leur message, elles font l’effort d’écrire et de s’adresser à un autrui public dans les codes linguistiques et culturels légitimes, c’est-à-dire dominants. Ces femmes savent comment présenter leurs plaintes et sous quelle forme leur sollicitation doit être construite pour qu’elle puisse être recevable, admissible et quelle n’apparaisse pas incongrue et déplacée. Ce sont ces éléments qui me font dire que ces femmes sont les plus intégrées des étrangères car elles semblent être relativement familières aux modèles de la démocratie conjugale qui privilégient la communication et non la force.
La plainte – écris-tu – doit être entendue comme un tort qui demande à être reconnu, autrement dit qui ne doit pas échapper à une exigence de justice ou qui demande à être départagé en justice. Cette phrase montre qu’en écrivant, ces femmes savent bien ce qu’elles veulent. Elles demandent réparation. Mais vont-elles jusqu’à envisager voire demander la séparation ?
Absolument ! En écrivant, ces femmes étaient sures qu’une plainte adressée à une association comme N.P.N.S. pouvait presque tout de suite être comprise car il y avait identification entre le récepteur et l’expéditeur. Elles pouvaient faire l’économie d’un certain nombre de démonstrations car de leur point de vue, ces associations pouvaient spontanément comprendre ce qui leur arrivait (même prénom, même origine nationale, même confession, etc.). Lorsqu’on n’est pas familier aux instituions et notamment à l’institution judiciaire, la plainte est un acte extrêmement difficile, compliqué et aléatoire. Il y a donc besoin d’être confortées, réconfortées et aidées dans cette démarche. Dans les années soixante et soixante dix, il y avait les mouvements féministes, des intellectuel(le)s, des partis politiques, des syndicats… Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Il n’y a plus de mouvement féministe, les partis politiques sont extrêmement loin de ces univers. Et il n’y a pas de parti « indigène ».
La dimension économique et matérielle semble absence dans les sollicitations…
Deux thèmes sont absents dans les courriers et le fichier téléphonique. Celui de la sexualité et la dimension économique de la violence.
La dimension de la dépendance économique se pose très brutalement pour les mineures et les jeunes filles qui veulent quitter le domicile parental afin d’échapper à un mariage forcé. La dépendance est de deux ordres : affective à l’égard des parents et économique qui se manifeste par la question suivante : « si je quitte le domicile parental, je vais où ? ». Pour les femmes, c’est aussi tout à fait explicite mais elles ne s’attardent pas sur cette dimension. Mais si elles n’ont pas pu quitter le domicile conjugal, c’est qu’en réalité elles ne savaient pas où aller. Et on ne part pas lorsqu’on n’a pas de formation, de qualification, de salaire, d’emploi, quand on n’est pas familier à l’univers professionnel, lorsqu’on a des gosses… Lorsque tous ces facteurs se combinent, alors il ne reste plus que la « patience » comme elles disent.
Comment vivent-elles cette « dénonciation » publique vis-à-vis de leur communauté ? Y a-t-il un sentiment de culpabilité ?
La culpabilité est quasi permanente. Mais elle n’est pas là où l’on croit. Pour les violences conjugales, elle se décline sous forme d’auto-culpabilisation. C’est-à-dire que les femmes violentées ne se questionnent pas sur les motivations du comportement violent. Elles ne se demandent pas pourquoi les époux (violents) leur font subir cette violence. C’est plutôt leur personne qu’elles mettent en cause en se disant « qu’est ce j’ai fait pour vivre cette situation ? ». Ce sentiment de culpabilité était également fortement présente dans les courriers envoyés par les femmes à Menie Grégoire.
Dans le mariage forcé, les arguments sont d’un autre ordre. Les jeunes filles pensent qu’en refusant l’alliance imposée, elles s’opposent à leurs parents et que par conséquent, elles leur font du mal car ces derniers ont la conviction qu’en les obligeant à épouser l’homme de leur choix, ils agissent pour le bien de leurs filles. Ces réflexions montrent bien que ces jeunes filles ont un sens critique développé.
L’un des résultats de cette enquête, c’est de montrer que l’espace familial est un univers extrêmement violent pour les femmes. Ces dernières n’ont d’ailleurs aucun mal pour décrire avec une très grande précision la figure du persécuteur qui n’est ni le frère, ni le quartier mais le père, la mère, le mari, l’ex… En d’autres termes, c’est celui qui a un intérêt immédiat à soumettre l’autre.
Comment peut on interpréter l’absence d’une interprétation religieuse dans les courriers ?
Dans le courrier où il est fait état de mariage forcé, il est question de tradition et de religion. Ces deux dimensions sont absentes dans la dénonciation de la violence conjugale. Sans aucun doute parce que dans une grande mesure les femmes reportent sur elles mêmes la faute et la responsabilité de leur malheur. Elles ne cessent de se demander si n’est pas de leur faute si elles sont frappées, si au fond elles ne méritent pas leur sort. Si la religion n’apparaît pas au premier abord comme système d’explication premier il n’en reste pas moins, qu’on le veuille ou non, qu’elle agit en connivence avec les valeurs machistes qui ont cours dans toutes les sociétés. A l’évidence, les femmes à la fois croyantes et pratiquantes sont les plus enclines à garder pour elles leur malheur et leur souffrance. Autrement dit, elles sont les moins promptes à dénoncer la violence qu’elles subissent. Elles ne s’habituent pas à la souffrance, elles pensent que la souffrance est constitutive de l’identité féminine : c’est ainsi car c’est dieu qui l’a voulu puisqu’il est le seul à décider de tout.
Ecrire. Dire. « Nommer les choses ». Dévoiler ses souffrances. Solliciter un tiers pour les aider à enrayer la violence est « un acte volontaire et souverain », écris-tu. .
Un acte souverain, c’est cette aptitude à se désigner comme sujet. Dire à haute voix et à la face du monde, est déjà un premier acte de souveraineté. Elles osent dire à quelqu’un d’autre « venez voir ce qui se passe chez moi » et elles demandent que cessent ce qu’elles jugent comme inadmissible. Elles usent encore de ce qui est de leur liberté, celui d’écrire pour suspendre le monde, le mettre à distance et l’examiner avec d’autres. Ces femmes sont parfaitement capables de parler elles-mêmes et de construire des récits parfaitement cohérents et intelligibles. Elles ont un point de vue qui vaut quasiment celui d’un certain nombre de personnes qui pensent étudier intelligemment ces populations.
Ce « pouvoir de faire » permet l’accès à un nouveau type de responsabilité où ces femmes qui expriment la violence qu’elles vivent « se constituent en sujets »…
Lorsqu’il y a crise, c’est qu’il n’y a plus de consensus sur la définition légitime. Le propre d’une crise c’est de fermer et d’ouvrir en même temps. Elle ferme des perspectives et en ouvre d’autres. Dans ces situations, l’épreuve de la violence permet une réflexivité sur les événements vécus. Et l’écriture est un biais qui favorise cet effort de réflexion sur soi et sur ses conditions de vie.
Les modalités d’examen de ces épreuves permettent de faire des expériences inédites notamment celle de la responsabilité ; car dire « je ne veux plus » ou adopter des comportements qui consistent à rechercher des informations sur internet ou dans son environnement pour solliciter de l’aide sont des attitudes tout à fait nouvelles. Ces actes qui peuvent paraître ordinaires pour beaucoup de personnes ne le sont pas pour ces femmes qui, à partir de la crise qu’elles vivent font de nouvelles expériences qui modifient la structure du monde dans lequel elles se connaissent et se reconnaissent différemment. La sollicitation d’un tiers et le recours au droit est l’une des expériences fondamentales que ces femmes vivent lors de ces crises. Autrement dit, le recours au droit est l’élément nouveau qu’elles introduisent entre elles et l’autre. Et cette donne revêt un caractère innovant car dans ce contexte, le droit est essentiellement défini comme la possibilité d’interpeller autrui pour venir voir ce qui se passe dans le domaine du privé. Le droit est sollicité pour devenir un mode de régulation dominant. Par ce biais, ces femmes font appel à la morale de la société et non pas à celle de leur communauté.
Y a-t-il dans cette écriture de soi et sur soi et dans cette mise à nu de soi et de ses souffrances sous forme de protestation publique une volonté de s’éloigner d’une définition traditionnelle et religieuse des rapports hommes/femmes ?
Je pense que nous sommes là dans une sorte de laïcisation de la religion, c’est-à-dire une redéfinition du religieux comme mode dominant de structuration des rapports entre les hommes et les femmes. En terre d’immigration, il y a des principes supérieurs à la religion. Tous les Musulmans ne battent pas leurs femmes. Ceux qui respectent les femmes le font au font au nom d’une représentation universelle de la dignité, de l’intégrité et du respect du corps.
Le conflit redéfini l’institution matrimoniale, familiale et la place de la religion. En terre d’immigration, la religion ne doit pas régir les rapports entre les hommes et les femmes et ne doit en aucun cas porter atteinte à la volonté et à l’autonomie des femmes. Dans les courriers de ces femmes, les trois dispositifs de production et de maintien de l’identité légitime : le couple, la famille et la religion ne sont pas radicalement remis en cause. Bien au contraire, ils sont maintenus mais c’est leur place et leur puissance qui sont redéfinies. D’une certaine manière, il s’agit d’un processus d’individualisation de la religion. Ainsi, les « persécuteurs » ne pourront plus justifier leurs actes au nom de la religion.
Les hommes battent-ils leurs femmes au nom de la religion ?
Les rapports de domination peuvent être légitimés par la tradition et la religion. C’est le coup porté qui change tout car cet acte, c’est le basculement dans un autre registre. Il peut y avoir dans les rapports de domination des négociations. Mais lorsque la violence intervient et lorsque l’autre est contraint à penser selon les catégories du persécuteur comme forme suprême d’aliénation, on n’est plus dans le même registre. La violence n’est pas fondée naturellement dans les relations hommes/femmes. Il y a basculement dans la violence dès lors que les rapports symétriques sont remis en cause. La violence intervient lorsque l’autre a le sentiment que l’épouse ou la jeune fille s’écarte de son rôle et qu’elle n’est plus conforme à la représentation qu’il se fait de la place qu’elle doit naturellement occuper.
Comment cette idée de redéfinition des rapports hommes et femmes se manifeste-t-elle dans les courriers et les fiches téléphoniques ?
Cette volonté de redéfinir les rapports entre les hommes et les femmes est très explicite. Elle s’exprime à travers des phrases qui ne laissent place à aucun doute. Ainsi, très souvent, ces femmes écrivent : « c’est mon égal et je suis son égale ». « Il m’humilie mais au nom de quoi serai-je sa bonne ?… ». Ces femmes vivent dans une société où il y a plusieurs modèles de conjugalité en concurrence. Il y a le leur qui peu à peu s’effrite et effrite la position dominante de l’homme au sein de ce modèle familial et conjugal qui largement encore minore dans le privé et dans le public la position de la femme. D’autres modèles gagnent du terrain qui impliquent une plus grande responsabilité des femmes et qui amoindrissent considérablement leur don de soi. Et c’est tant mieux.
« La représentation que l’on a de l’immigré est soit « populiste, c’est-à-dire paré de toutes les vertus, soit misérabiliste, c’est-à-dire il apparaît sous la figure du malheur, de la souffrance, et de l’exclu… », écris-tu. Cette étude semble préconiser un autre type de conception des populations immigrées. Quelle est cette représentation ?
C’est une entreprise théorique extrêmement compliquée. La première question qui se pose est de savoir s’il est possible de parler de ces populations sans utiliser la notion d’immigrés et les catégories qui leurs sont traditionnelles attachées (intégration, discrimination, etc.). Comment pourrait-on alors les qualifier ?
La seconde question concerne un examen critique du paradigme de la domination. La théorie de la domination est-elle suffisante pour rendre compte de ces pratiques et de ces univers ? Ne faut-il pas, sans renoncer à la théorie de la domination, la travailler plutôt dans le sens d’un « assouplissement » ? Par exemple dans ce travail sur la violence faite aux femmes les relations de domination existent mais elles sont plus compliquées qu’on le croit même entre les hommes et les femmes. Il serait peut être plus pertinent de mobiliser le paradigme de la sociologie des épreuves qui n’exclurait pas une sociologie de la domination mais qui se recentrerait sur l’expérience des personnes. C’est plutôt ce type de proposition théorique et paradigmatique que je propose et forcément cela nécessite de revisiter tous les discours dominants sur l’immigration et l’immigré( e).
Editions Calmann-Lévy, 2008, 228p, 18€