Sur les chemins de la Dignité, de la Liberté, de l’Humanisme.
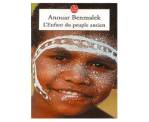
C’est en travaillant sur les récits romanesques de Anouar Benmalek que j’ai relu « l’Enfant du peuple Ancien ». C’est alors que j’ai pris conscience que bien que publié en 2000, ce roman est d’une brûlante et incontestable actualité. Car à travers cette histoire qui prend aux tripes, indigne, révolte et vient bouleverser le sens commun, l’auteur s’attache à « déterrer des vérités oubliées et à établir les connections que l’on s’acharne à gommer » (Edward Saïd), et ce, en mettant en lumière l’attitude des colons anglais vis-à-vis des Aborigènes de Tasmanie et ainsi une politique qui s’inscrit dans "une perspective répressive, manipulatrice » meurtrière voire criminelle.
Devant cette « horreur » qui gît là face à son entendement, l’auteur s’interroge :« Mais est-ce seulement imaginable qu’un peuple disparaisse de la terre seulement parce qu’un autre l’a voulu ?. » Et ce questionnement vient inévitablement faire écho à la politique menée par des hommes qui se positionnent en maîtres du monde et s’arrogent le droit de réprimer, de manipuler, d’affamer, d’appauvrir, de violenter… l’autre, cet étrange et sauvage « animal » qu’il faut à tout prix dompter. Pour la bonne cause et pour le bien-être du monde. Bien évidemment !
« L’Enfant du peuple ancien », Editions Pauvert.
1871. Et son cortège d’événements politico-historiques. D’un bout du monde à l’autre. En Afrique du Nord, en Algérie coloniale, l’insurrection menée par Mohamed Amokrane dit El Mokrani dans la région de Kabylie et soutenue par les tribus du Sud est réprimée par l’armée française. Arrestations. Déportations en Nouvelle-Calédonie. Exil. Parmi les insurgés déportés, un homme. Kader.
En France, un vent révolutionnaire souffle sur Paris. La Commune. Au bout de deux mois, l’insurrection est réprimée dans le sang. Arrestations. Condamnations à mort. Déplacements forcés. Déportations en Nouvelle-Calédonie. Parmi les déportés, une femme. Lislei.
Sur la côte Sud-est du continent australien, sur l’île de Tasmanie, les colons anglais achèvent l’extermination des Aborigènes. Génocide. Assassinat de tout un peuple à l’exception d’un enfant. Tridarir. Survie du dernier descendant d’un peuple dont la « destruction » à la fois physique et symbolique et par-dessus tout intentionnelle et programmée a été passée sous silence. Ignorée. Oubliée. Enterrée hâtivement dans les fins fonds de la « poubelle » de l’Histoire humaine.
Kader. Lislei. Evadés de la Nouvelle-Calédonie. Tridarir. Capturé par des « black catchers » (chasseurs de Noirs). Cet enfant ? Une « curiosité » congénitalement inhumaine du point de vue des colons pétris de stéréotypes et de jugements essentiellement méprisants, humiliants et manipulateurs. Mais encore ? Une bête de somme. Un « vulgaire » objet destiné à être vendu à des musées.
Kader. Lislei. Tridarir. Rencontre fortuite sur un bateau. Leurs points communs ? Dominés. Humiliés. Blessés. Exilés. Déclassés. Déplacés. Des vies éclatées. Défigurées. Destins croisés. Destins scellés. Dans leur malheur. Leur souffrance. Les voilà qu’ils s’unissent et se lancent dans la grande, l’extraordinaire aventure de la survie, ce long périple au dénouement libérateur grâce à l’esprit d’entraide et de solidarité. Et inévitablement, sur le chemin vers la Liberté, la Dignité, l’Humanité, ils apprennent à se connaître et à se reconnaître. Sur fond d’amour et d’amitié, ils s’adoptent au point de former un cocon familial, le foyer, symbole de protection, source de chaleur et de lumière ; ce lieu où l’on peut se réfugier en toute sécurité, en toute confiance, en toute quiétude.
L’histoire à la fois tragique et bienheureuse de ces trois personnages et leurs rêves de vie et d’amour ont longtemps erré dans les cieux. En attente d’être racontés, d’être révélés au monde, d’élucider leurs secrets, de percer leur mystère. En attente de se poser quelque part afin de reposer en paix. Et c’est à travers un roman qui prend l’allure d’un talisman de la générosité, de la solidarité, de l’amour, de la liberté et de la dignité qu’Anouar Benmalek, romancier, poète et nouvelliste invite les lecteurs à se perdre dans les méandres de cette histoire longtemps tenue à l’écart de la connaissance humaine ; une histoire qui, en s’accrochant inlassablement aux rives du naufrage collectif, s’est peu à peu frayé un chemin vers la lumière pour graver ses empreintes sur les murs de la Mémoire publique. Et ressusciter de ses cendres dispersées dans l’univers au gré des vents.
« L’Enfant du peuple ancien », « un roman d’amour et d’aventures », disent certains. Certes. Mais avant tout un livre qui cherche à réhabiliter l’histoire d’un peuple victime d’une idéologie déshumanisante et qui selon l’auteur « méritait autant que nous de vivre ». Cette idée ô combien humaniste est essentiellement exprimée à travers une écriture « benmalékienne » - oserions-nous dire- qui se présente comme une suite de mots, d’images et d’idées dont le sens et les significations révèlent une histoire passionnée et passionnante ; une histoire qui pénètre l’imaginaire, l’envahit et le possède pour mieux le féconder ; une écriture où l’irruption, le surgissement et le suspense tiennent les lecteurs en haleine et jouent de leurs sentiments et de leurs émotions. Peur. Peine. Chagrin. Tristesse. Douleur. Joie. Bonheur. Empathie. Sympathie. Haine. Amour.
À présent, Kader, Lislei et Tridarir peuvent reposer en paix. Les oiseaux migrateurs ont picoré une à une les graines de cette histoire aux allures humanistes pour les semer à la surface de la terre. Oui. Leur histoire voyage. Elle vogue par-dessus les nuages, les mers, les océans, les continents et vient inévitablement, inexorablement faire écho aux idées de feu Edward Saïd, en l’occurrence celle qui préconise cette attitude qui consiste à « désapprendre l’esprit spontané de domination ».
Publié en 2000. Primé à plusieurs reprises. Traduit en huit langues. Une traduction en langue arabe et un projet d’adaptation au cinéma en cours. Quel regard portes-tu sur ce roman sept années après sa publication ?
À sa sortie, L’enfant du peuple ancien a été extrêmement bien accueilli, ce dont évidemment je me félicite. Cependant, je considère qu’il y a eu un malentendu cardinal dans le succès qu’il a eu auprès de certains critiques qui ont voulu le réduire à un « roman d’amour et d’aventures ». De mon point de vue, ce livre est d’abord profondément tragique car il traite essentiellement d’un génocide, en l’occurrence l’extermination des Aborigènes de l’île de Tasmanie par les colons anglais au dix-neuvième siècle. Autrement dit, il s’agit de l’histoire d’un peuple qui a disparu dans le néant car un autre l’a décidé. C’est, pour résumer, d’abord et avant tout l’histoire d’un crime contre l’Humanité. Cet aspect génocidaire est quasiment absent de la majorité des articles consacrés à ce roman. Il y a quelque part, au fond de moi, une profonde insatisfaction car j’ai la conviction qu’on ne lui a pas rendu justice sur le plan qui m’importait le plus. Des critiques bien intentionnés ont trop souvent enfermé les personnages de ce livre dans une image « exotique », donc caricaturale. Et ce regard « exotisant », je le retrouve même chez des compatriotes algériens, étonnés, pour d’aucuns, que j’écrive sur les Aborigènes de Tasmanie. Ce point de vue m’a été un jour exprimé sans fioritures par une collègue écrivaine qui, lors d’un colloque en Sicile m’a interpellé sur un ton dépréciatif : « Mais qu’est ce qui t’a pris d’écrire sur les Aborigènes ? » sous-entendant « Est-ce que nous n’avons pas assez de problèmes comme ça pour écrire sur d’autres peuples ? » Cet état d’esprit est certainement dû au complexe du colonisé car il ne viendrait à l’esprit d’aucun lecteur du Tiers-Monde de dénier à un écrivain du monde dit développé d’écrire sur n’importe quelle autre contrée que la sienne. Mais peut-être, et c’est le plus grave, n’y a-t-il dans la tête de beaucoup d’entre nous, du nord au sud de notre planète, de « véritable » génocide que s’il concerne des victimes européennes ?
Selon Mohamed Dib, l’Enfant du peuple ancien est un roman qui permet de « sortir de la ghettoïsation de la littérature maghrébine ».
Je suis flatté que le grand Mohamed Dib ait apprécié ce roman. Cette ghettoïsation à laquelle il fait allusion est, de mon point de vue, une évidence. Et qui sont les constructeurs des murailles de ce ghetto virtuel ? Ce sont les Algériens eux-mêmes qui s’interdisent certains sujets, comme s’ils avaient peur des potentialités enfouies en eux. Ce n’est pas parce que nous sommes Algériens que nous sommes condamnés à écrire spécifiquement et exclusivement sur l’Algérie. De toute façon, en écrivant ce livre, à aucun moment je n’ai eu le sentiment que je m’éloignais de l’Algérie. Bien au contraire, j’avais la conviction que je participais en tant qu’Algérien à la grande aventure de l’Humanité. Le fait d’appartenir à tel ou tel pays ne doit pas constituer une entrave à l’expression de ma part d’Humanité. Je fais partie de plusieurs mondes. Et un écrivain n’est pas réduit au pays dont il est issu. Toute l’Humanité lui appartient.
Pour certains, ce roman peut représenter « un exotisme géographique » puisque l’action se déroule sur des terres lointaines et étrangères à leurs habitus.
Chacun est exotique pour l’autre. En réalité, l’exotisme n’est pas un mal en soi. Ce qui est préjudiciable, c’est la tendance à l’enfermement de l’autre dans son exotisme, dans une « essence » qui le définirait et le programmerait une fois pour toute, le privant d’une part de son libre arbitre
D’autres peuvent y voir une sorte « d’exotisme historique » et ne pas se sentir concernés par l’histoire des Aborigènes de Tasmanie et des autres personnages du roman.
Dans son histoire réelle, l’Algérien a été douloureusement concerné par la Nouvelle-Calédonie et, dans certains cas, par l’Australie. Car, parmi les prisonniers algériens déportés en Nouvelle-Calédonie, certains ont réussi à s’évader et ont cherché refuge en Australie. Le « Babor Australia », ce bateau mythique réceptacle de toutes les envies d’évasion des jeunes chômeurs algériens depuis les années 1990, était au fond déjà une réalité au dix-neuvième siècle. Les Algériens, à l’instar des autres peuples de la planète, ont participé à la grande transhumance des êtres humains sur notre planète. L’exotisme guette tout le monde. Les Algériens étaient des indigènes pour les Français ; mais les Canaques, à leur tour, étaient considérés comme tels par les Algériens bannis. A l’époque, la plupart des déportés algériens n’accordaient aucun prix à la liberté des autochtones, allant même, lors de plusieurs révoltes des Canaques, jusqu’à s’allier à l’armée française pour les combattre. Jusqu’à présent, les Canaques considèrent les descendants d’Algériens plutôt comme des colons, des usurpateurs, et non comme des victimes de l’Histoire comme eux. À chacun donc « son » indigène à asservir ou à mépriser…
Comment l’idée d’écrire ce roman a-t-elle germé ?
J’ai commencé à réfléchir sur ce roman lorsque je suis tombé par hasard sur un article qui traitait de la déportation commune des révoltés d’El Mokrani et des vaincus de la Commune de Paris. Sur les mêmes bateaux, des insurgés algériens et des Français communards affrontaient une tragédie commune : l’exil à l’autre bout du monde. L’élément déterminant qui a provoqué l’écriture de ce roman a été la découverte qu’en Nouvelle-Calédonie, la majorité de ces déportés, algériens et communards, qui s’étaient pourtant soulevés au prix de leur vie et dans leurs régions respectives pour une certaine idée de la liberté, s’étaient mis sans hésitation au service des oppresseurs coloniaux pour combattre l’aspiration à cette même liberté, mais de la part de Noirs calédoniens. Il y a eu, bien évidemment, parmi ces déportés algériens et français, une poignée de grandes figures qui refusèrent ce marché de dupes. À ce stade de mes recherches, je pensais centrer le roman sur cette rencontre entre les déportés d’Algérie et les communards français. Puis, au fil de mes lectures, j’ai déniché un document d’état civil relatif à un mariage entre un Algérien insurgé et une Française communarde. Et comme, en tant que romancier, je ne m’interdis rien — puisque la « vie réelle », elle, ne se refuse aucune péripétie, fut-elle la plus invraisemblable —, j’avais envisagé une évasion de mes personnages vers l’Australie. A l’époque, il y avait eu effectivement quelques prisonniers qui avaient réussi à s’enfuir vers l’Australie, dans des conditions que l’on devine terribles si on se rappelle la distance qui sépare la Nouvelle-Calédonie de ce pays.
Et les Aborigènes de Tasmanie ?
J’ai pris connaissance du génocide des Aborigènes tout à fait par hasard. Ils sont entrés dans mon roman presque par effraction. Au cours de mes lectures, j’ai buté sur une phrase d’une imposante monographie consacrée à l’histoire de l’Australie qui laissait entendre, mais en passant, qu’il y avait eu un génocide sur l’île de Tasmanie. C’est d’abord la structure, choquante, de la phrase qui avait éveillé mon attention. Elle disait en substance : « Le loup de Tasmanie a disparu vers 1876, à peu près en même temps que le dernier aborigène de Tasmanie à la suite des massacres perpétrés par les Anglais ». À la lecture de cette phrase (la seule qui évoquera ce génocide tout au long de ce volumineux ouvrage…), je me suis demandé si, pour les auteurs de cette monographie, le génocide d’êtres humains noirs n’était en fait qu’un « incident », d’importance négligeable devant la disparition du précieux loup de Tasmanie. Intrigué, j’ai souhaité en savoir un peu plus. Je ne me sentais pas capable de continuer à écrire l’histoire de mes évadés en Australie, en faisant semblant d’ignorer qu’au même moment un génocide arrivait à son effroyable terme…
À partir de quels documents historiques l’histoire de ce génocide a-t-elle été reconstituée ? Et comment cette population y était-elle représentée ?
La documentation disponible dans certaines bibliothèques et, en particulier, au musée de l’Homme de Paris est riche en la matière. Les Anglais, grands bureaucrates devant l’Eternel, notaient tout dans le moindre détail. Les écrits relatifs à cette population mettent en évidence la totale déshumanisation des Aborigènes aux yeux des spoliateurs anglo-saxons. Les colons considéraient les Aborigènes de Tasmanie plutôt comme des animaux ou, plus exactement, comme le chaînon manquant entre le singe et l’Homo Sapiens. C’est pourquoi des laboratoires de recherche (!) et des musées ne montraient aucun scrupule à commander à des « black catchers » (chasseurs de Noirs) des cadavres d’Aborigènes pour les « étudier » et exposer ensuite leurs squelettes derrière des vitrines. Ces chasseurs d’hommes n’hésitaient pas à massacrer des familles entières d’Aborigènes pour satisfaire leurs « généreux » commanditaires.
Les documents que j’ai pu consulter m’ont permis de rencontrer une civilisation aborigène paradoxale : extrêmement démunie sur le plan matériel, et très riche et complexe sur le plan spirituel. Sa disparition est, de mon point de vue, un énorme gâchis, une expérience irremplaçable d’un groupement humain qui, par la volonté de quelque uns et pour des raisons essentiellement financières, a été anéantie. Cet acte est en réalité un double assassinat : celui des Aborigènes, d’une part, et celui de la mémoire de cet assassinat, d’autre part. C’est à partir de ces éléments que le nouveau cours du roman s’est imposé à moi. Je ne pouvais continuer l’histoire telle que je l’avais envisagée au départ parce que la perspective et le but de mon projet venaient de basculer complètement : c’est un enfant, Tridarir, que je suppose être le dernier aborigène ayant survécu à Truganini, la dernière femme aborigène — à laquelle le roman est d’ailleurs dédié —, qui est devenu le personnage central de mon récit. Ainsi, le nouveau roman se proposait de combiner trois événements de l’Histoire qui se sont déroulés à peu près à la même période, mais en faisant en sorte que le génocide des Aborigènes de Tasmanie en devienne l’évènement central.
Le roman met en scène l’histoire de trois personnages qui se rencontrent par la force des choses ; des êtres blessés, déçus, dominés, exilés malgré eux. Kader est un insurgé d’Algérie, déporté en Nouvelle-Calédonie. Sa présence met en évidence des bribes du contexte colonial algérien, en l’occurrence l’insurrection déclenchée en 1871 par El Mokrani. Cependant, Kader est originaire de la région du Sud algérien alors que l’insurrection contre les forces coloniales françaises a principalement eu lieu en Kabylie. Pourquoi le choix de la région du sud ?
La révolte déclenchée par El Mokrani et le cheikh El Haddad commence en Kabylie pour s’étendre rapidement aux trois quarts du pays, dont l’Est et le Sud. Dans le Sud, la révolte sera conduite par le cheikh Bouchoucha, qui tombera aux mains des Français et sera fusillé à la prison de Constantine ; dans cette même région, cette révolte se prolongera ensuite par l’insurrection d’El Amri, de l’oasis de Biskra, conduite par Cheikh Mohamed ben Yahia et Ahmed ben Aïech avec plus de deux mille guerriers. La répression, assurée par plus de cent mille soldats coloniaux, sera sanglante sur l’ensemble du territoire national puisqu’elle coûtera la vie à plus de vingt mille insurgés algériens. Mais mon roman ne prétend pas du tout décrire la révolte d’El Mokrani dans sa ampleur historique ; mon livre vise simplement à suivre un personnage singulier tout le long d’une vie singulière. Ce personnage, comme tout personnage de roman, est absolument unique et ne se veut représentatif de rien et surtout pas de la diversité sociologique et ethnique des insurgés d’El Mokrani.
Kader est le neveu de l’Emir Abdelkader. Il est « prince de sang ». Pourquoi l’accent sur « la noblesse » de sa naissance et de son appartenance sociale ?
Je voulais un personnage issu d’une « grande » famille pour, à la fin du roman, le réduire, par l’ironie de l’écriture romanesque, en un banal et ordinaire habitant d’un continent de l’autre côté de la planète. Kader est le neveu de l’Emir Abdelkader, personnage extraordinaire par excellence et pour lequel j’éprouve une grande admiration. Pourtant, l’exil l’oblige à s’affubler d’une nouvelle identité celant un immense secret : celui d’avoir appartenu à une famille princière mêlée à la grande Histoire d’un autre pays. La trajectoire de Kader montre que nous sommes, certes, façonnés en partie par l’Histoire, mais pas seulement par elle. L’Histoire nous malmène, mais, dans le pire des malheurs, nous laisse aussi une partie de notre libre arbitre et quelques possibilités, même minimes, de choix. Au bout du compte, il est parfois vital de considérer les événements que nous pourrions qualifier d’« indépendants de notre volonté » comme une sorte de « butin de vie », en paraphrasant Kateb Yacine qui parlait de « butin de guerre » dans un autre contexte. Autrement dit, il est essentiel d’appréhender les soubresauts de la vie de la manière la plus positive possible. Dans son malheur, Kader a été mis en contact avec d’autres êtres humains, parfois de la pire espèce ; il a vécu des expériences extrêmement pénibles et a réussi malgré tout à se comporter de manière humaine. Toute cette somme d’épreuves a contribué à le forger et à le transformer profondément ; s’il n’est plus prince de sang, il est devenu quelqu’un de bien plus important encore : un être humain aimé par d’autres êtres humains, en l’occurrence Lislei et Tridarir
Kader sait qu’il ne reviendra plus en Algérie. Cette certitude transparaît lorsque, dans un rêve, il parle à Nour, son premier amour : « Le passé est un pays dans lequel je ne vivrai plus. Pourquoi insistes-tu ? Jamais, jamais plus, je ne reviendrai chez nous », monologue-t-il.
Kader est convaincu que son départ d’Algérie est définitif en raison des conditions de l’époque. L’histoire se déroule au dix-neuvième siècle. Kader est à l’autre bout du monde ; il s’est évadé ; il n’a pas d’argent. Il est donc impossible pour lui, matériellement, de revenir dans son pays. Il ne se laisse prendre au piège de la douceur du passé que dans le rêve. Dès que le sommeil le quitte, il se retrouve face à une réalité extrêmement brutale. Et pour survivre, il doit combattre la tentation de la mélancolie et de la déchirante nostalgie à l’égard de l’enfance et du monde qu’il a laissés derrière lui. Il a été expulsé de son univers — l’Algérie de ses parents — et il est conscient qu’il ne pourra plus jamais y retourner. Cet état de fait est cruel. Mais il n’y peut rien. Le passage du temps —celui qui nous éloigne irrémédiablement de ceux qu’on a pu aimer — fait autant mal qu’un pansement qu’on arrache. L’enfant du peuple ancien est, dans un sens, le roman des morts successives qui marquent notre existence et de la manière de faire face aux deuils à répétition qu’elles entraînent afin de continuer à vivre : comment supporte-t-on le choc de l’irrémédiable ? la fin d’un pays ? d’un peuple ? de nos souvenirs ? de notre passé. Les personnages n’ont plus que leurs rêves pour revivre leur passé. Ils aiment leurs rêves, mais ces rêves les font terriblement souffrir. Pour continuer à exister dans leurs têtes, le passé réclame d’eux un prix qui se révèle très élevé.
La référence à la Commune se fait à travers le personnage féminin, Lislei qui n’est pas communarde mais la sœur d’un communard. Pourquoi ce lien indirect à la Commune ?
J’ai d’abord été tenté par le choix d’une vraie communarde, telle Louise Michèle par exemple. C’est une femme extrêmement courageuse qui, déportée en Nouvelle-Calédonie, a exprimé une solidarité sans compromis avec les révoltés canaques. Mais un tel personnage est trop « beau » : trop héroïque, faisant toujours les « bons » choix, il n’est pas crédible dans un roman. Eh oui, le roman doit parfois s’astreindre à être moins flamboyant que la réalité ! Lislei, par contre, est un personnage ordinaire, avec toutes les faiblesses que cela implique. Ce sont l’époque et les circonstances qui l’amènent à quitter son pays, à « abandonner » sa nièce. Elle n’est pas à l’origine de ce qui lui arrive ; elle se retrouve déportée au bout du monde malgré elle et contrainte à vendre son corps pour s’évader. Elle fuit en compagnie de l’étranger absolu qui est « l’Arabe » qu’elle méprisera donc et qui la méprisera à son tour. En choisissant une non communarde, je voulais moins de prévisibilité et laisser ainsi à Lislei une plus grande liberté de penser et d’agir dans mon roman. De tous les personnages, elle est finalement la plus courageuse car, face à l’enfant, elle assumera sans tergiverser ses responsabilités. Peut-être dans le cadre d’un comportement de réparation, de réappropriation de sa propre dignité…
Tridarir, enfant, est présenté comme le dernier survivant des Aborigènes de Tasmanie. Ce qui signifie la disparition de ce peuple. Un fait imaginé ? Pourquoi le choix de cette configuration romanesque ?
Il était important pour moi que l’enfant porte un vrai prénom aborigène — qui est d’ailleurs celui d’un des tout derniers Aborigènes de Tasmanie. Le choix d’un enfant comme ultime survivant du cataclysme le plus épouvantable que puisse subir une partie de l’humanité — le génocide — est capital dans la construction de mon livre. Je souhaitais de toutes mes forces que le lecteur s’attache à ce peuple mystérieux et lointain, les Aborigènes de Tasmanie, privé par la cruauté d’autres hommes de son droit à l’expérience amère et merveilleuse de la vie sur terre. Et comment mieux le faire qu’en suscitant l’attachement pour un enfant, le symbole même de l’innocence ? Par ailleurs, c’était le seul « moyen » de forcer Kader et Lislei à sortir de leurs enfermements respectifs et construire une espèce d’humanité réduite à trois. Il s’agit là de la trilogie sacrée : l’homme, la femme et l’enfant. Car, s’ils n’avaient pas fini par trouver en eux cette bonté à offrir à un enfant, les deux adultes seraient devenus des « sauvages », c’est-à-dire des êtres humains pour lesquels la survie est le but dernier de l’existence, même au prix de tout sentiment de pitié ou de solidarité. C’est Tridarir qui « humanise » Kader et Lislei ; c’est lui qui va, en définitive, les sauver de l’ensauvagement. J’ai beaucoup de sympathie et de compassion à l’égard de mes personnages parce que, hélas, ils ne sont que trop proches d’une certaine réalité historique. Pendant les trois ans qu’a duré la « construction » de L’enfant du peuple ancien, Tridarir a été constamment présent dans mon esprit : j’écrivais pour le sauver, au moins dans mon livre. Alors que le « vrai » sauvetage, ainsi qu’en avait décidé le verdict implacable de l’Histoire, n’était plus possible
« Un roman d’amour traversé par l’intense lumière de la confiance », lit-on quelque part. Un roman d’espoir, car il montre que face à la violence, à la sauvagerie, à la folie et à l’inhumanité des hommes, des êtres s’unissent et s’entraident pour échapper à la mort. Cet esprit de solidarité et d’entraide semble être important dans la construction de l’histoire.
Les trois personnages forment l’Humanité minimale. Sans la confiance que les uns accordent aux autres, ils seraient incapables de survivre. Tridarir est le plus faible des trois car il a subi l’inimaginable : la perte de ses parents, la perte de son peuple, de sa terre, de sa langue même — puisqu’il n’a plus personne avec qui la partager ! Kader et Lislei comprennent que si, eux, ont été chassés de leur monde, l’enfant l’a été de manière plus radicale encore. C’est grâce à Tridarir qu’ils réapprennent à se comporter de manière humaine. La seule présence de l’enfant leur impose des devoirs. Et c’est dans ce contexte que naît l’amour entre eux. Pour Kader, Tridarir et Lislei sont son « nouveau » monde, une petite Algérie de substitution. C’est grâce à la femme et à l’enfant qu’il peut continuer à vivre sans succomber au désespoir de l’exil irrévocable. Ce roman est à la fois triste et porteur d’espoir. Au moment de leur mort, lorsque les trois personnages font le bilan de leur vie, ils prennent conscience qu’ils ont aimé et ont été aimés —et que, donc, d’une certaine manière, ils n’ont pas totalement échoué. Le suicide de Tridarir était la partie la plus difficile à écrire. Je voulais que quelqu’un survive à l’Aborigène afin que ce dernier connaisse au moins un dernier bonheur : celui d’être pleuré par un être humain qui l’aime. C’est pourquoi j’ai fait en sorte qu’il disparaisse avant Kader.
Les personnages sont conçus selon un modèle positif, engagés dans une lutte contre les Blancs, colons et conquérants représentés comme des êtres foncièrement inhumains, violents et donc négatifs… Approche manichéenne selon certains critiques.
Décrivez-moi un camp de concentration nazi et essayez de n’être pas manichéen envers les gardiens SS, essayez de trouver des côtés positifs, même minimes à ceux qui avaient décidé de nettoyer la terre de ceux qu’ils considéraient comme des sous-hommes. De la même manière, les personnes qui ont « effacé » les Aborigènes de la surface de notre planète sont, pour moi, des « méchants » absolus. Il ne faut pas dédouaner les coupables à force de trop vouloir les comprendre. Trop d’indulgence, trop de compréhension risquent de faire perdre de vue l’essentiel : la programmation de la disparition d’un groupement humain par d’autres êtres humains. Le crime serait de considérer qu’un génocide n’en est pas totalement un si ceux qui l’ont commis ne le considèrent pas comme tel. Je sais bien que le crime ultime c’est l’assassinat du Blanc par le Blanc et que celui du Noir par le Blanc n’est pas considéré comme un crime irrémissible par certains. Je suis persuadé que certains génocides suscitent plus d’indignation que d’autres. Mon roman portant sur le génocide d’une population, j’ai choisi d’emblée le camp des victimes ; et ce n’est pas parce que cette population est noire qu’elle est moins importante.
Chez chacun des personnages, le rêve a une fonction protectrice et réparatrice ; un moyen de se remémorer sa famille, son pays, son passé . Le tout représentant un univers essentiellement sécurisant.
La notion de rêve est fondamentale dans ce livre. Mais un roman n’est-il pas un grand rêve puisque tout le monde sait bien qu’il est basé sur la fiction ? Le rêve est nécessaire à tout être humain. Le présent est évanescent ; le passé est notre seul trésor ; et la l’unique façon de le revivre au point de croire qu’il est la réalité, c’est le rêve. L’homme qui ne rêve pas meurt. C’est, disent les scientifiques, le subterfuge qu’a trouvé la Nature pour qu’au réveil, nous gardions notre identité de la veille : si nous ne rêvions pas, nous ne saurions pas qui nous sommes après une nuit de sommeil ! Le rêve est le moyen par lequel le passé est maintenu en vie. Pour Kader, Lislei et Tridarir, leur monde est vécu principalement à travers leurs rêves.
Le Rêve semble revêtir une signification particulière chez les Aborigènes de Tasmanie. Dans ses propos, Tridarir personnifie le Rêve : « Un rêve qui ne sait pas ! C’était la première fois. Même les rêves vont mourir » soliloque-t-il. Quelle est la symbolique de la notion du Rêve dans la civilisation aborigène ?
La civilisation aborigène est fondée sur le Rêve. Dans leur théogonie, c’est l’un des aspects fondamentaux de la réalité de l’Univers. Selon cette vision spirituelle, des entités complexes, les Rêves, sont à l’origine de la création de l’Humanité, et cette dernière a pour devoir perpétuel de protéger ces Rêves. Si l’homme ne vénère pas ses Rêves, alors ceux-ci disparaissent, et lui avec eux. Et l’hécatombe ne concerne pas qu’un être humain isolé, mais l’entière structure sociale. Pour les Aborigènes, le Rêve donne naissance à tout ce qui est vivant ; en parcourant les sentiers des Rêves, les fameux songlines, l’être humain contribue à leur revivification et, par conséquent, à « attiser » sa propre existence.
Ce roman peut-il être appréhendé comme un appel à l’humanisme, approche qui exclut toute ambition dominatrice privilégiant les principes de liberté, de justice et de dignité ?
En écrivant ce roman, je voulais porter à l’attention des lecteurs un fait de l’Histoire passé sous silence. Mon projet n’était pas de susciter de la pitié à l’égard des Aborigènes de Tasmanie. Il était celui de faire prendre conscience qu’un crime abominable avait été commis à leur encontre, alors qu’en tant qu’êtres humains ils méritaient tout autant que chacun de nous de vivre l’expérience du passage sur terre. Si ce roman contribue un tant soit peu à inscrire le souvenir de ces gens dans notre mémoire commune, je considérerai que j’aurai atteint mon objectif.
L’exotisme a très souvent servi de prétexte pour dénier aux autres l’humanité dont ils sont porteurs. Cet état d’esprit a permis et a justifié leur exploitation, voire leur massacre. Mais, dépouillé des oripeaux de l’exotisme, le plus « étrange » des êtres humains se révèle exactement comme nous, c’est-à-dire capable du pire comme du meilleur. Nous ne devons jamais l’oublier.