« Mon nom est rouge » d’Orhan Pamuk : A la manière des miniatures persanes
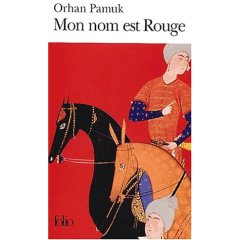
Lauréat du Prix Nobel de littérature en 2006, écrivain à succès dans de nombreux pays grâce à ses livres traduits dans plus de 20 langues, Orhan Pamuk n’est, aujourd’hui, plus à présenter. En vérité, cet écrivain qui a mis son art à la recherche de l’âme mélancolique de sa ville natale, Istanbul, a brillamment réussi à trouver de nouvelles images spirituelles pour le combat et l’entrelacement des cultures propres à son pays : la Turquie. Mais même en étant considéré comme un « un phénomène exceptionnel dans la littérature mondiale », Orhan Pamuk a toujours su garder ses pieds sur terre afin de regarder le monde toujours avec cette même humilité que tout le monde lui reconnaît.
Quant à la littérature, pour lui, elle a toujours été sa vie. Le roman est plus qu’un livre, pour Orhan Pamuk, c’est d’abord un pont entre différentes rives. Pour mieux comprendre cela, il serait peut-être bon d’écouter la confession d’Orhan Pamuk : « J’ai passé ma vie à Istanbul, sur la rive européenne, dans les maisons donnant sur l’autre rive, l’Asie. Demeurer auprès de l’eau, en regardant la rive d’en face, l’autre continent, me rappelait sans cesse ma place dans le monde, et c’était bien. Et puis un jour, ils ont construit un pont qui joignait les deux rives du Bosphore. Lorsque je suis monté sur ce pont et que j’ai regardé le paysage, j’ai compris que c’était encore mieux, encore plus beau de voir les deux rives en même temps. J’ai saisi que le mieux était d’être un pont entre deux rives. S’adresser aux deux rives sans appartenir totalement à l’une ni à l’autre dévoilait le plus beau des paysages. »
Quant à « Mon nom est rouge », il demeure incontestablement l’un de ces romans majeurs. Cette magnifique œuvre a pour cadre la ville de Istanbul en 1591. En effet, la ville est partagée entre nouvelles tentations et antiques inquiétudes. Dans ce contexte, Orhan Pamuk nous élabore une intrigue policière et amoureuse qui nous fait pénétrer dans le milieu des peintres miniaturistes et enlumineurs. Ainsi, l’un d’eux, le spécialiste des dorures, a été assassiné (c’est sa voix qui ouvre ce vaste roman polyphonique, avec changement d’auteur, tour à tour, à chacun des 59 chapitres) parce qu’il tentait d’empêcher la réalisation d’un livre commandé par le Sultan, pour sa gloire personnelle —son règne vient de voir le millième anniversaire de l’Hégire—, mais surtout pour impressionner le doge de Venise.
Néanmoins, le désir d’alliance des styles ottoman et vénitien a débouché sur une confrontation entre Orient et Occident, à travers deux écoles différentes : celle de Maître Osman et celle de Monsieur l’Oncle, deux façons de se placer face à la réalité, à la religion et aux grands problèmes de l’univers. D’un côté, nous avons le Maître Osman pour lequel il est juste de suivre scrupuleusement la tradition anonyme des maîtres enlumineurs de la Perse, de l’Afghanistan et même de la Chine : il ne faut jamais représenter ce que l’œil voit, mais ce qu’Allah voit, une abstraction de la réalité, parfaite et immuable dans le temps. Seule la cécité permet d’atteindre le stade de vision suprême, quand il n’est plus nécessaire de voir pour peindre, l’ensemble de la réalité d’Allah étant déjà imprimé dans la mémoire du miniaturiste.
Et de l’autre, Monsieur L’Oncle qui, au contraire, est fasciné par les techniques des peintres occidentaux qu’il a découvertes au cours de ses voyages, parce que l’art conçu selon leurs propres canons offre l’éternité, aussi bien à celui dont on a fait le portrait (c’est là, la tentation du Sultan) qu’à celui qui l’a exécuté dans un style différencié.
Or, aux yeux des fondamentalistes, il s’agit surtout d’un livre impie, qui porterait atteinte à la religion en adoptant le goût de la différenciation développée par les peintres italiens. Plus tard, Monsieur l’Oncle est frappé à son tour, et c’est son neveu, Le Noir, qui se met à la recherche de l’assassin pour conquérir la belle Shékuré, fille de l’Oncle, dont il est amoureux depuis douze ans.
A partir d’ici, le lecteur plonge à coup sûr dans un livre d’un grand intérêt, entre la haute érudition, la fresque historique, la belle sensibilité poétique et l’exceptionnel talent de narrateur d’Orhan Pamuk car l’auteur a visiblement choisi de s’exprimer à travers un très grand nombre de voix et ce, dans l’optique d’écrire « un roman historique à la troisième personne qui donne à son auteur une autorité excessive », a-t-il confié à une journaliste italienne. Il faut dire que faire raconter un récit par des personnes différentes lui donne une agréable touche de légèreté surtout lorsqu’on sait que dans « Mon nom est rouge » les problèmes philosophiques, iconographiques, religieux et idéologiques sont la toile de fond du roman. Enfin, ce livre est à la fois une réflexion sur l’art et un historique de la peinture persane. Orhan Pamuk évoque les techniques, décrit — ou plutôt lit — nombre des plus belles miniatures anciennes qui sortirent des mains des plus grands Maîtres et miniaturistes. Ces artistes y consacraient toute leur vie. Et cette activité pouvait les mener à la cécité, un mal qu’ils considéraient comme le comble de leur art et un don de Dieu.
Mais, ce qui fait aussi l’intérêt du roman d’Orhan Pamuk, « Mon nom est Rouge », c’est l’ambiance du conte oriental qui flirte avec l’intrigue policière. En dernier lieu, bien qu’il soit difficile à lire, ce roman laisse le signe sur ceux qui arrivent au bout... et ce sans avoir sauté des pages car finalement rien que le regard raffiné et subtil que nous offre Orhan Pamul à travers son écriture devrait nous pousser à lire et à relire ce roman magistral.