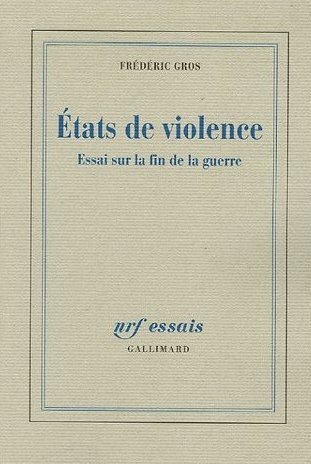Frédéric Gros prend les choses autrement. L’originalité de son approche tient justement à ce qu’elle ne relève pas du géopolitique. Lui travaille en sous-sol, pour ainsi dire, là où se forment les grandes attitudes culturelles face à la guerre. Dans son ouvrage, « Etats de violence, essai sur la fin de la guerre », Frédéric Gros prend acte d’une nouvelle économie de la violence qui affecte nos sociétés en profondeur. La figure de la guerre classique, celle qu’initient des acteurs étatiques bien définis et que sanctionne une victoire militaire, cette figure-là n’est plus. Lui succède un « état de violence » généralisé dont il nous reste à penser la nature.
Plutôt que d’analyser les nouveaux états de violence en termes de « barbarie » ou d’« ensauvagement », vous proposez de suivre la logique positive qui les soutient. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Au départ, c’est à partir de la lecture qui est le plus souvent faite des grands phénomènes de violence contemporain comme le terrorisme ou un certain nombre de conflits endémiques dans des pays déstructurés, que, pour moi, cette exigence s’est faite sentir. Ce qui me choque dans ces analyses, c’est le fait de lire la violence contemporaine comme un retour de l’animalité, une résurgence de la nature, ou encore, comme l’irruption de formes de violences non civilisées.
Ce qui implique que nous aurions le monopole de la bonne violence ?
Absolument. Ce qui laisserait croire que nous aurions l’apanage des violences polies. Au fond, ce qui m’intéresse, c’est de poser la question suivante : en quoi ces formes d’ultraviolence (qu’elles s’exercent au Sierra Leone ou en Colombie) disent quelque chose de notre identité contemporaine ? Si vous interprétez ces violences comme retour à la brutalité archaïque, vous passez nécessairement à côté de la question.
Quel types de savoirs mobiliser pour les décrire, non pas en creux, mais positivement ? Doit-on faire appel à la sociologie ?
L’approche philosophique me paraît convenir dans la mesure où celle-ci montre sa capacité à créer de nouveaux concepts. Au fond, les grandes philosophies politiques ont toujours dressé l’état des lieux d’une époque. Prenez Hobbes. C’est à partir du moment où émerge une unité politique nouvelle (l’Etat souverain, disposant du monopole de la force armée), que la philosophie va problématiser l‘Etat et le conceptualiser, ce qui le justifie en retour. Il faudrait aujourd’hui créer de nouveaux concepts correspondant à la situation actuelle. Notez que cela ne veut pas dire les inventer de toute pièce. Un concept comme celui de la sécurité n’est pas nouveau en soi. La tâche de la philosophie consiste à dénaturaliser l’évidence de son emploi, à l’inquiéter, à comprendre ce qui se dit de nouveau et d’inouï.
Justement, quelle place accordez-vous au concept de sécurité aujourd’hui ?
C’est à mon sens le concept majeur. Encore faudrait-il le problématiser en profondeur. Le concept de sécurité redéfinit le sujet politique dans sa dimension de vivant. Dans la logique bio-politique à laquelle il introduit, le sujet comme atome politique se découvre sensible et vulnérable avant de se découvrir comme porteur de droits. Le vrai scandale devient la souffrance, davantage que la privation de droits.
Annonce-t-il un nouveau rapport à la mort ?
Oui. Dans la tradition grecque de la cité ou républicaine chez Machiavel, le citoyen se définit par sa capacité à mourir. Aujourd’hui, le sujet politique est ce qui doit être protégé de la mort, des agressions, des traumatismes. Cette protection du vivant est le lieu par lequel l’Etat se relégitime. Il joue là, si j’ose dire, sa dernière carte.