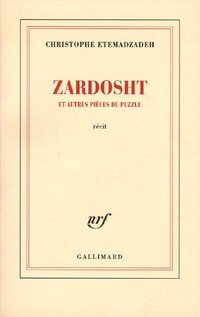"Zardosht" est un grand livre sur la niaiserie amoureuse,
sur les "petites fiancées" irréelles auxquelles on
s’attache au sortir de l’adolescence. Mais la description du
ratage amoureux est immédiatement placée ici sous le signe du
père. Dans quelle mesure ces deux choses s’articulent-elles
? L’intuition de base serait-elle : à relation au père
manquée, vie sentimentale irréelle ?
Je ne me suis jamais formulé les choses de façon aussi limpide, mais je suppose en effet qu’un père absent ou effacé ne prédispose pas le fils à devenir un conquérant. Contre qui lutter, quand on n’a ni prédateur ni rival ? Avec qui apprendre à lutter ?
Dans un autre ordre d’idées, votre question me fait penser à une chanson de Brel :
Elles, elles ont l’arrogance
Des filles qui ont de la poitrine
Eux, ils ont cette assurance
Des hommes dont on devine
Que le papa a eu de la chance
Ce parallèle entre le père qui a "réussi" et un caractère sexuel secondaire me laisse rêveur... Evidemment, ces problèmes ne sont pas simples. Il y a tant de facteurs qui entrent en jeu qu’il est difficile de prouver quoi que ce soit. Quoi de plus commun, par exemple, que de rater ses premières expériences amoureuses ? (- Rater les suivantes, peut-être ?) Disons qu’il pourrait y avoir une manière de les rater qui serait propre aux "enfants sans père". Mais c’est sûrement accorder encore trop d’importance à la relation au père.
Je précise d’ailleurs, pour qu’il n’y ait pas de malentendu, que je ne me déteste pas assez pour pouvoir souhaiter que les événements qui m’ont formé n’aient pas eu lieu. Si je ne refuse pas les mots "ratage", "irréel", "manqué", je ne voudrais pour rien au monde avoir réussi ce que j’ai raté, avoir réalisé ce que j’ai rêvé, avoir eu ce qui m’a fait défaut.
Loin de moi l’idée qu’on pourrait
réussir quoi que ce soit en amour ! Soyons snobs, évoquons
ici la mémoire de Lacan, lequel nous aurait gourmandé pour
une telle espérance... Le ratage n’est pas un accident
possible, c’est un horizon indépassable ! De sorte que ce
qui s’oppose au ratage, ce n’est pas la réussite, c’est
l’humour. "Zardosht" est d’abord et avant tout un évènement
comique. Je défie quiconque de rester impassible devant la
description qui est faite du petit Christophe à l’école,
avec cette jeune Anna B à peine rencontrée dont le regard
semble dire : " Adieu, adieu...", ou bien de ce père qui, tout en
étant absent (à noter que le fils ne sait même plus de quoi
il est l’absence) n’en distribue pas moins bons points et
mauvais points sur son éducation : d’où les reproches, les
recommandations, etc. On a quand même un peu l’impression
que le monde se fout de la gueule du monde. Est-ce que je me
trompe ?
Je ne sais pas... Que mon père ait été du genre à se moquer du monde, c’est indéniable, que j’aie hérité de cette tendance, c’est possible, mais j’ai l’impression que vous avez trouvé drôles des passages qui ne le sont qu’involontairement. J’hésite à m’en réjouir !
Je vais vous sembler naïf, mais je suis obligé d’avouer que l’adieu silencieux à Anne B., par exemple, n’est pas à mes yeux un moment comique. C’est le problème avec l’ironie : entre ceux qui ne la perçoivent pas et ceux qui vous prêtent la leur... ça me rappelle une remarque d’un ami qui trouvait drôle et méchante la phrase, au début de Zardosht, qui décrit ma mère comme quelqu’un "qui n’a jamais souhaité le malheur de personne". Mais je trouve ça très beau, moi, ce côté "je tends l’autre joue" ! En tout cas, il y a des moments - mes moments naïfs ? - où je trouve ça très beau...
Bref, ce n’est pas que votre lecture me déplaise, mais je ne m’en sens pas digne !
Mince alors. Se pourrait-il que ce petit passage sur
votre mère ne soit pas drôle ?
A chacun de juger si c’est drôle ! Mais ça n’a pas été écrit pour faire sourire, surtout pas la phrase dont je viens de parler.
Il y a dans ce portrait une distance qu’on peut prendre pour de l’humour, mais elle est presque nulle dans la phrase de clôture.
De façon plus générale, je me suis d’abord demandé très simplement comment étaient les choses, comment je les voyais, et je n’ai pris mes distances qu’après coup. Le texte a connu plusieurs versions. La première était très "premier degré"... Il en reste évidemment quelque chose.
J’ai lu il y a quelques jours une petite critique de mon livre parue dans Epok. On y parlait d’un humour "qui se prendrait tout de même au sérieux". La formule ne m’a pas fait plaisir - elle n’était pas faite pour ça -, mais je l’ai trouvée assez juste.
Dont acte ! Tout ça nous prouve au moins une chose :
définir le type d’humour ou d’ironie dont relève votre
écriture est un sujet beaucoup plus complexe qu’il n’y
paraît. Tant mieux. Il n’y a pas à chercher de fin mot sur
ce plan (pas plus qu’ailleurs). Puisque vous évoquez les
critiques, comment avez-vous vécu l’apparition
(permettez-moi d’utiliser un terme un peu chrétien en
hommage à votre mère) de votre ouvrage ? Si je ne me trompe
pas, il s’agit de votre premier livre...
C’est une expérience assez déstabilisante. La satisfaction d’avoir atteint un objectif - si dérisoire soit-il - ne reste pas longtemps sans mélange. Et puis, en l’occurrence, il y a la nature de l’ouvrage, trop intime, à la limite du dégoûtant. Je savais en l’écrivant que je le ferais lire à certains, mais j’étais persuadé qu’il ne serait jamais publié. J’aurais bien aimé pouvoir en interdire la lecture à la plupart de mes proches.
Après, il y a les commentaires, les jugements, etc. Quand on est vaniteux, c’est insupportable. Un éloge mesuré est pire qu’une insulte, et on doit encore sourire. Les compliments immérités ou délirants font plaisir un instant, mais on est vite dégrisé, et honteux. Quant aux comptes-rendus que j’ai pu lire, ils étaient souvent truffés d’approximations et de lieux communs. Je suppose que c’est la règle, et je suppose que je m’en accommoderai.
"Zardosht" se présente au lecteur comme un récit
autobiographique. Le narrateur s’appelle Christophe, le
récit semble familial, introspectif, psychologique... On
aura tôt fait d’en conclure qu’il s’agit d’un roman intime
de plus. Telle n’est pas du tout ma lecture. La biographie
repose sur des fictions, et c’est à ces fictions que vous
nous renvoyez. Le père du narrateur voue un véritable culte
à son propre père, d’où l’évocation d’un Iran mythique, la
célébration de la Perse, l’exaltation de la pensée
zoroastrienne... On est en plein dans ce que Freud appelle
le roman familial et tout devrait se dérouler normalement
sauf que le fils n’entre pas dans la fiction du père. D’où
les reproches : "Tu es toujours si calme, si posé ! Tu as un
tempérament de Nordique, de Flamand... Tout est aseptisé,
chez toi. Pas d’exubérance, rien de solaire...". Quel regard
portez-vous sur cette "réserve" du fils vis à vis du "souci
romanesque" du père ?
D’abord, je précise que les adjectifs "introspectif", "psychologique" (et toute la série, jusqu’à "nombriliste") ne me font pas horreur. Mon goût, mon goût de lecteur me porte vers l’autobiographie. La vie repose sans doute sur des fictions mais, en tant que fictions, elles ne m’intéressent pas plus que ça. Concernant mon père, il m’est difficile de prendre assez de recul pour considérer cette "réserve", qui est toujours la mienne, à l’endroit de ce que j’appellerais plutôt mensonge que fiction. Je me souviens d’une phrase de Nietzsche qui conseille de se méfier des hommes pittoresques. Mon père était un homme très pittoresque.
Je m’aperçois que j’utilise un terme (fiction) qui ne
correspond pas à votre expérience, et je m’en excuse.
Contrairement à ce que j’ai avancé, la psychologie ne vous
fait pas "peur". Pourrions-nous approfondir ce point ?
Pourrions-nous aborder également vos livres-clefs, les
écrivains qui vous servent de référence en littérature ?
Je n’ai pas étudié la science qui porte aujourd’hui ce nom, mais si je prends le mot psychologie dans un sens très général (et il me semble que c’est ce qu’on fait lorsqu’on reproche à un auteur de sombrer dans la psychologie), je peux dire que je m’y intéresse. Le mot semble devenu infâmant, c’est étrange. Le fait qu’il y ait une mauvaise psychologie ne suffit pas à l’expliquer : il y a aussi une mauvaise philosophie, or si je dis d’un livre qu’il est "plein de philosophie", personne ne va croire que c’est une critique. Bref, je pense que c’est un phénomène qui relève de l’histoire littéraire, de la mode. Proust, par exemple, est indéniablement un très fin psychologue, mais c’est un aspect de son oeuvre sur lequel on passe aujourd’hui assez vite. La remarque vaut pour Nietzsche. Est-ce la psychanalyse qui a rendu poussiéreuse cette psychologie-là, celle des moralistes ? Je ne sais pas. Personnellement, j’ai le sentiment d’en avoir appris au moins autant sur « l’esprit » chez les deux auteurs précités que dans L’Interprétation des rêves, par exemple.
Bien que j’aie encore peu lu (parce que j’ai commencé tard, parce que je lis lentement, et parce que lire est à mes yeux plus un travail qu’un loisir) les écrivains et les livres que je pourrais citer comme "références" sont nombreux. Si je m’en tiens à ceux à qui j’ai pensé en écrivant Zardosht, parce qu’il y avait quelques points communs entre ce qu’ils avaient fait et ce que je voulais faire, je dois notamment citer le Georges Perros d’Une Vie ordinaire, Pierre Michon, et puis L’Invention de la solitude de Paul Auster (tout cela en plus du modèle paralysant qu’est A la recherche du temps perdu). Je devrais également parler de Breton, mais ce serait un peu long d’expliquer pourquoi.
J’ai aussi beaucoup pensé à des œuvres non littéraires. Sur la question du père, par exemple, je vais d’une chanson de Dominique A au Retour du Jedi en passant par les bandes dessinées Maus, Jimmy Corrigan, Le Journal de mon père, etc. Le sujet a été souvent traité en BD, ces dernières années, et il l’a souvent été avec sensibilité et originalité.
Quelle liste ! Il faudrait reprendre ces
références point par point. Je crains que nous n’en
ayons pas l’espace. Parlez-nous au moins de Dominique A !...
Eh bien, il y a une chanson (dont le titre est "Pères") que je trouve très intéressante, notamment parce ce qu’elle ne considère pas la relation père-fils du seul point de vue du fils. Je n’ai pas l’expérience de la paternité ; il y a des choses auxquelles je n’aurais pas forcément pensé sans cette chanson : l’impossibilité pour le fils de connaître l’homme qu’était son père (sans même parler de l’enfant qu’était son père), la jalousie que le père est obligé d’étouffer à la naissance du fils, la complaisance avec laquelle il laisse la place - dès le début, et pas seulement en disparaissant -, la distance que la mort du père accroît entre la mère et le fils, etc. Tout cela sans parler, bien sûr, des raisons moins intellectuelles qui m’attachent à cette chanson.
Il paraît qu’en France tout se termine en chansons. Cher
Christophe, je vous laisse le mot de la fin...
"Tout mot est un mot de trop." (Cioran)